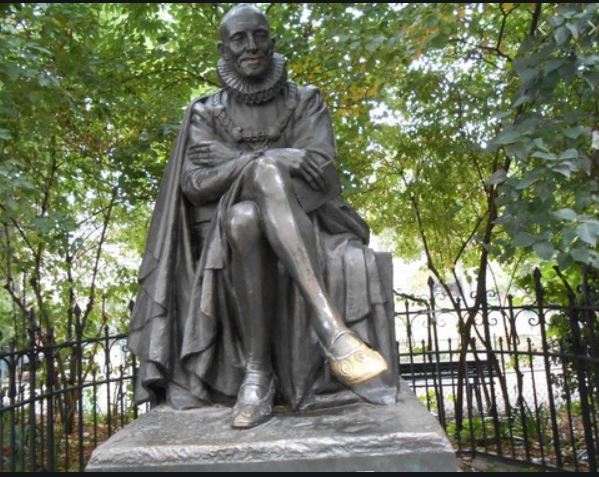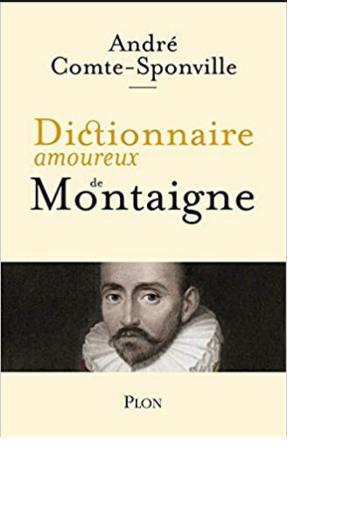Sa cuisine est époustouflante. Il est l’un des meilleurs cuisiniers au monde. Un modèle pour tous et une source d’inspiration pour les chefs de la jeune génération. Pénétrer dans l’univers gastronomique d’Eric Frechon, c’est s’embarquer pour Cythère. On ne touche plus terre, catapulté jusqu’aux étoiles par l’échelle aromatique, l’alchimie des flaveurs inédites, les sapidités inimitables de ce génie de la cuisine. On adore sa poularde de Bresse transfigurée par un bouquet d’écrevisses, comme des roses pimpantes de la mer qui piqueraient au vif une volaille bien terrestre. On s’enthousiasme pour ses sublimes macaronis farcis, truffe noire, artichaut et foie gras, gratinés au vieux parmesan. On pleure de plaisir devant ce mémorable rouget de roche, émouvant comme un tableau, avalé par une fleur de courgette et farci d’un caviar d’aubergine… A la table 3 étoiles d’Epicure, le corps tout entier est convié au plaisir. Même le cerveau est à la fête. En bouche, on va de surprise en surprise, le palais vibre, s’émerveille au contact de saveurs inoubliables, de tendres textures, et de parfums rares comme si l’excellence d’un plat avait le pouvoir d’affiner nos sensations. De les décupler, de les révéler. C’est la richesse de l’aliment qui en nous donnant son goût « ouvre en nous une nouvelle bouche, une deuxième langue » affirme Michel Serres dans son essai « Les Cinq Sens », soulignant au passage qu’étymologiquement « l’homo sapiens » est l’homme qui sait goûter, qui a le palais délicat. Ce n’est donc pas un hasard, si tous les palais fins se pressent des quatre coins de la planète, pour savourer à la table d’Epicure, ce temple gourmand incontournable, la cuisine hautement poétique de ce magicien, ce maître qu’est Eric Frechon. Un festin de Frechon, c’est la félicité assurée. C’est fulgurance sur fulgurance. C’est tout simplement Eric Frechon…
Qu’est-ce qui a de l’importance pour vous dans la vie ?
Le plaisir, au sens large du terme.
Pour vous la cuisine, c’est le goût des autres ?
Non, c’est mon goût, que je partage !
Avez-vous un souvenir inoubliable en matière d’émotion gustative ?
Oui, les senteurs de la tarte aux pommes de ma maman… Sinon, je garde en mémoire un souvenir assez désagréable : la première fois que j’ai goûté du caviar. Autant maintenant, j’adore parce que c’est un mets que l’on apprend à déguster, c’est le fruit d’une éducation, autant la première fois, je n’ai pas aimé du tout.
Avez-vous déjà goûté chez vos confrères une recette sublime ?
Evidemment ! La première qui me vient à l’esprit, c’est une bécasse absolument incroyable de Ducasse, au Louis XV à Monaco. Ce souvenir remonte à une trentaine d’années.
Vous sentez vous à votre place, chez vous, dans une cuisine ?
Oui, je suis très à l’aise dans mes cuisines, parce que j’aime être en contact avec les jeunes, j’aime cette dynamique et cette passion.
Votre plus grand bonheur professionnel a-t-il été l’obtention du titre de Meilleur Ouvrier de France en 1993 ?
En fait, j’en ai eu deux : il y a d’abord eu le titre de Meilleur Ouvrier de France, un titre personnel puis l’obtention des trois étoiles, qui récompense toute une équipe.
Feuerbach affirmait « L’homme est ce qu’il mange ». Quel est votre rapport à la nourriture ?
Ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés ! Nous, les cuisiniers, nous goûtons énormément de choses à longueur de journée mais nous avons du mal à faire de vrais repas assis. Donc, notre rapport à la nourriture n’est pas tout à fait normal !
Quelle a été votre plus belle rencontre dans le monde de la cuisine ?
Pour n’en citer qu’une, ce serait Paul Bocuse.

Poularde de Bresse en vessie
De quoi êtes-vous le plus fier ? De votre ascension fulgurante, d’avoir épinglé trois étoiles au firmament du restaurant Epicure ou d’avoir enchanté le palais de milliers de gastronomes ?
Incontestablement, d’avoir enchanté le palais de milliers de gastronomes !
Pensez-vous que l’estomac influe sur le cerveau ?
Lorsqu’on a faim, on éprouve une frustration, il suffit de combler cette faim pour ressentir aussitôt la satisfaction de la satiété, donc une forme de bien-être. Un estomac heureux, c’est un cerveau enclin à l’optimisme. Panse et penser vont de pair ! Ils sont indissociables. Les sensations gustatives réveillent, stimulent l’intellect. La nourriture enseigne des choses à l’homme et renseigne sur l’homme. C’est pour cette raison que ce rapport à la nourriture me semble si important. Brillat-Savarin d’ailleurs ne cessait de répéter : « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ».

Le restaurant Epicure
Vous êtes à la tête du restaurant du Bristol : Epicure, du nom du philosophe grec. On confond souvent l’épicurisme avec l’hédonisme, croyant qu’être épicurien, c’est ne songer qu’aux plaisirs, par exemple les plaisirs de la table avec tout ce que cela comporte d’excès. Or, c’est tout le contraire, l’épicurisme est un ascétisme. Dans sa correspondance à un ami, Epicure écrit : « Envoie-moi un petit pot de lait caillé afin que je fasse bombance » Pour Epicure, on peut éprouver un grand plaisir avec un ingrédient tout simple. Le Bristol prône-t-il la même tempérance ?
C’est même notre philosophie ! On peut travailler du caviar, qui est un produit assez noble mais on va lui donner un poireau grillé, qui est quelque chose de très terrien, de très basique dans la cuisine, et ce sera en légume unique. On ne travaille pas que des produits nobles. On fait du radis-beurre, on fait du hareng pommes à l’huile, des choses vraiment toutes simples. C’est à nous, après, de les mettre en scène pour les rendre trois étoiles. On privilégie une extrême simplicité, en préservant et sublimant la quintessence du produit.
Vous êtes un merveilleux dialecticien de la gastronomie. Vous réconciliez l’irréconciliable, vous mariez des saveurs incompatibles, des alliances improbables. Par exemple, beaucoup de vos plats, infiniment originaux, célèbrent les noces de la terre et de la mer comme le foie gras de canard aux huîtres, la poularde de Bresse cuite en vessie aux écrevisses et truffes, le ris de veau aux couteaux, le lapin au poulpe. Cherchez-vous à inventer de nouvelles correspondances entre les ingrédients ?
Je suis né en Normandie, entre terre et mer, cela se ressent dans ma cuisine. C’est vrai que cette dichotomie m’intéresse tout particulièrement parce que ces mélanges surprenants, ces alliages inédits permettent d’innover et de rendre les plats plus originaux. Effectivement, c’est un peu ma patte mais c’est aussi ça le trois étoiles, c’est arriver à marier des choses à priori incompatibles, en mélangeant des ingrédients que d’emblée personne n’aurait eu envie d’associer. La règle du trois étoiles est que pour chaque plat, quand on goûte ce plat, on doit s’en souvenir. Un trois étoiles, c’est un plat de mémoire… Les plats de mémoire passent par l’originalité des plats, par le mariage des goûts, par un visuel surprenant, par la magie d’une saveur inoubliable, par une émotion mémorable.
La poularde de Bresse cuite en vessie, c’est un hommage à « Monsieur Paul » ?
C’est plutôt un hommage à la Mère Brazier, « Monsieur Paul » n’a fait que la réinterpréter à sa manière. Mais ces plats sont tellement représentatifs de la cuisine française qu’il faut garder ces traditions.
On dit que votre « Lièvre à la Royale » est à se damner. La sauce, sublime de bout en bout, est un morceau d’anthologie. Avez-vous fait évoluer cette recette au fil du temps ?
Je dis toujours, j’ai mis trente ans pour faire mon Lièvre à la Royale ! Quand on arrive dans le métier, on apprend à faire des Lièvres à la Royale. Une fois chef, vous réalisez votre premier Lièvre à la Royale que vous tentez d’améliorer d’année en année. Et puis un jour, vous vous dites « là, je l’ai ! » et à partir de là, vous n’y touchez plus !
Depuis combien de temps, n’y touchez-vous plus ?
A peu près quatre-cinq ans !
Est-ce difficile à réaliser comme recette ?
Selon moi, c’est la recette qui représente le mieux la cuisine française et le savoir-faire du cuisinier. Parce qu’il y a le choix du produit, il y a les marinades, il y a des cuissons, il y a des sauces, il y a des farces. C’est-à-dire que toutes ces traditions françaises se retrouvent en un plat. Sans compter la sensibilité du cuisinier. Prenez deux cuisiniers, avec la même recette écrite et les mêmes ingrédients, à l’arrivée, on n’aura pas le même Lièvre. Pour l’un, les os seront plus caramélisés, pour l’autre, la sauce sera plus onctueuse…
Pour un petit dîner chez vous, quel est votre menu préféré ?
Ce serait un bon poulet de ferme rôti. Avec en dessert, une tarte cuite (une tarte aux pommes ou une tarte aux pêches.)

Julien Alvarez, chef pâtissier du Bristol et Eric Frechon
Actuellement, quels sont les desserts à l’honneur sur la carte de l’Epicure ?
Il y a le citron de Menton givré au Limoncello. Comme j’aime bien recréer l’atmosphère des produits, nous donnons vraiment la forme du citron au citron. Julien Alvarez, notre chef pâtissier, a créé aussi un dessert au chocolat « Fève de Cacao », mousseux et croquant à la fois. On fait un lait fumé avec de la vanille, on lui fait un appareil mousseux à base de fève de cacao, avec de la fève de cacao cristallisée. On le déguste à même la cabosse du chocolat.

Dessert « Fève de cacao »
Votre cuisine est intemporelle, elle n’épouse pas les modes mais les saisons. Vous ne cherchez pas à être tendance, vous cherchez juste à être pleinement vous-même. Est-ce pour cette raison que vous êtes devenu le chef le plus à la mode ?
Je ne suis pas le plus à la mode… mais effectivement, je fais une cuisine intemporelle, ça c’est certain ! Je ne n’endors jamais sur ce que je fais, je remets tous les ans tout en question, à part bien sûr quelques recettes incontournables comme La Poularde de Bresse et Le Lièvre à la Royale où je sens que je ne pourrais pas les emmener plus loin, tellement elles sont abouties. Mais sur tout le reste, en effet, ce sont les saisons qui nous font changer les cartes. Si, cette année, on a un très joli plat d’asperges (on les propose avec un sabayon au vin jaune), l’année suivante, on en recrée un nouveau pour essayer de faire encore mieux. Notre cuisine, c’est de l’intemporel qui dure dans le temps.
Un dîner à l’Epicure, c’est de la pure poésie, un rêve devenu réalité, une fête des sens, une expérience inoubliable ?
C’est ce que l’on tente de faire en tout cas, tous les jours et pour chaque personne. Nous sommes ouverts sept jours sur sept, midi et soir. Au total, 100 personnes œuvrent en cuisine, dans notre laboratoire de création, pour satisfaire les clients du restaurant l’Epicure, mais aussi du 114, la brasserie, du café Antonia en terrasse où l’on fait quand même 150 clients l’été, et du room service.
Vous avez de magnifiques mains ! La cuisine, c’est d’abord et avant tout le tactile ?
C’est drôle ce que vous dites… Quand on s’est connu, Clarisse (qui est devenue mon épouse) m’a dit « tes mains sont impressionnantes, je suis tombée amoureuse de tes mains » ! C’est un fait, la cuisine commence par le toucher. Quand on a un produit absolument magique en main, c’est plus que plaisant. On prend un grand soin à le lever, à le travailler, à le déposer dans une assiette. Par ce contact, on transmet de l’amour…
J’ai l’impression que vous avez le goût de l’absolu. Vous flirtez avec la perfection, l’excellence, sans jamais vous contenter du moyen ou du médiocre, comme si vous exigiez toujours davantage. Ce goût de l’absolu engendre le sublime. Etes-vous un perfectionniste ? Visez-vous toujours l’inaccessible ?
Vous m’avez parfaitement décrit ! Je suis un gros travailleur qui a réussi à développer les potentialités, les richesses qu’il portait en lui, grâce au Bristol, parce que dans cette belle maison, j’ai des patrons qui ont eu l’intelligence de me faire confiance, de m’accompagner et de me laisser m’exprimer. Ici on a la meilleure cuisine, la meilleure brigade, les meilleurs produits. Après, il n’y a plus qu’à s’exprimer ! Je suis un homme très heureux et accompli, même si c’est vrai que le désir de perfection rend parfois un peu insatisfait.

Le Bristol
Le Bristol est un sublime hôtel, c’est même l’hôtel favori des clients de Booking.com. Woody Allen a tourné « Midnight in Paris » au Bristol. Il y a séjourné durant plusieurs semaines. Comment est-il ?
Malheureusement, je ne l’ai pas croisé beaucoup, parce que ce sont des gens qui sont difficilement accessibles. De plus, il travaillait énormément. Il ne venait pas dîner au restaurant mais on a fait beaucoup de service en chambre.
Depuis des années, vous êtes célébré partout dans le monde. En 2009, en plus de recevoir le troisième macaron Michelin, vous êtes élu « Chef de l’année ». Dans la foulée et durant trois années consécutives, l’Epicure est élu « Meilleur restaurant d’hôtel au monde ». En 2015, vous êtes élu 7ème sur 100 (aux côtés de Pierre Gagnaire, Paul Bocuse, Alain Ducasse,Thomas Keller, Joan Roca, Michel Bras…) du classement des chefs du monde qui incarnent au mieux les valeurs de la profession et proposent une cuisine incontournable. Qu’est-ce que cela fait d’être l’un des plus grands chefs au monde ?
Honnêtement, je vous avoue que je ne fais pas trop attention à tous ces titres… Bien sûr, je suis très heureux et très fier de les recevoir ,mais je ne m’y attache pas. Je reste très humble là-dessus parce que demain tout peut changer. J’avoue que je ne me laisse pas distraire par ce qui se fait ailleurs, ni à l’extérieur ni même à l’étranger. Je vis tellement en autarcie ici que je fais ma propre cuisine telle que je la ressens, et je ne me laisse pas perturber par toutes ces modes, par cette course effrénée à la nouveauté, aux cuisines exotiques ou aux tendances fluctuantes.

Macaronis façon Eric Frechon
Avez-vous reçu au Bristol des Présidents de la République française ? Quels sont leurs plats préférés ?
Emmanuel Macron n’est pas encore venu… François Hollande est venu en banquet mais jamais au restaurant. Par contre Nicolas Sarkozy adorait mes macaronis (macaronis farcis truffe noire, artichaut et foie gras de canard, gratinés au vieux parmesan). J’aurais presque pu les appeler « Macaronis Nicolas Sarkozy » ! Il en a tellement parlé dans tous les articles de presse que ce macaroni est devenu la Soupe aux truffes VGE de Paul Bocuse !
Vous consacrez beaucoup de temps à transmettre votre passion de la cuisine, à former des apprentis, des stagiaires, des cuisiniers qui deviendront les Grands de demain. Pourquoi cette mission vous tient-elle tant à cœur ?
J’estime que le fait de passer Meilleur Ouvrier de France nous confère des devoirs. On a quelque part un devoir que l’on s’impose à soi-même – ce n’est pas une règle – qui est un devoir de transmission. Il s’agit de préparer les grands de demain, d’assurer la relève. A un moment donné, c’est une belle satisfaction pour nous aussi de voir ces petits grandir. Et puis c’est un peu ma cuisine, mon style, qui perdurera à travers d’autres cuisiniers. Ils garderont un « esprit Frechon » !
Ce sera « L’Ecole d’Epicure » !
Exactement !
Vous êtes à la tête du « Lazare » (un superbe « restaurant bistronomique » installé sur le parvis de la gare Saint Lazare), du « Minipalais » au Grand Palais, et du « Drugstore » Publicis en haut des Champs-Elysées. Vous signez la carte estivale d’un restaurant à Saint-Tropez « La Petite plage ». Vous écrivez des livres de recettes plus alléchantes les unes que les autres, comme « E » de Eric Frechon paru aux éditions Solar, qui composent une magnifique bibliothèque gourmande. Qu’est-ce qui peut encore faire rêver le fabuleux cuisinier que vous êtes ?
Le concours des Meilleurs Ouvriers de France arrive bientôt. Ce concours très exigeant qui récompense l’excellence du savoir-faire français demande des mois de préparation à tous ceux qui souhaitent le passer. On va tout faire pour aider les cuisiniers qui s’y présentent à décrocher ce titre prestigieux. Ce sont de vraies satisfactions pour nous. Après, il y a aussi les plus belles créations que l’on invente au quotidien dans nos cuisines….C’est ça qui nous fait vraiment rêver.
Enfin, avec qui aimeriez-vous dîner ?
Il y a énormément de personnes avec qui j’aimerais dîner ! Par exemple, Clint Eastwood, pour qui j’ai beaucoup d’admiration, j’adore ses films ! J’apprécierais aussi de partager un moment avec Michel Onfray autour d’une table, c’est un homme très intéressant…

Eric Frechon dans sa cuisine
Propos recueillis par Isabelle Gaudé