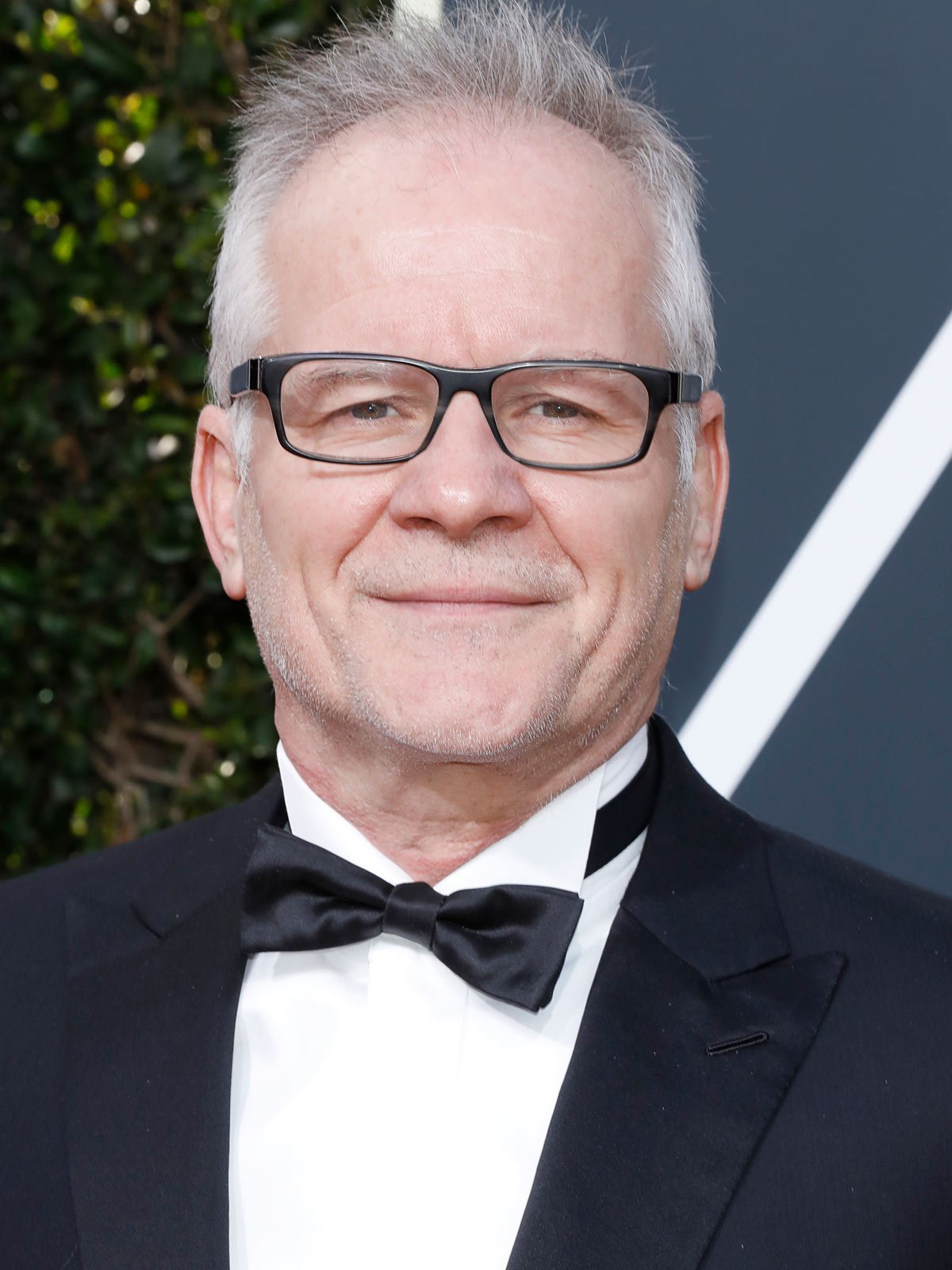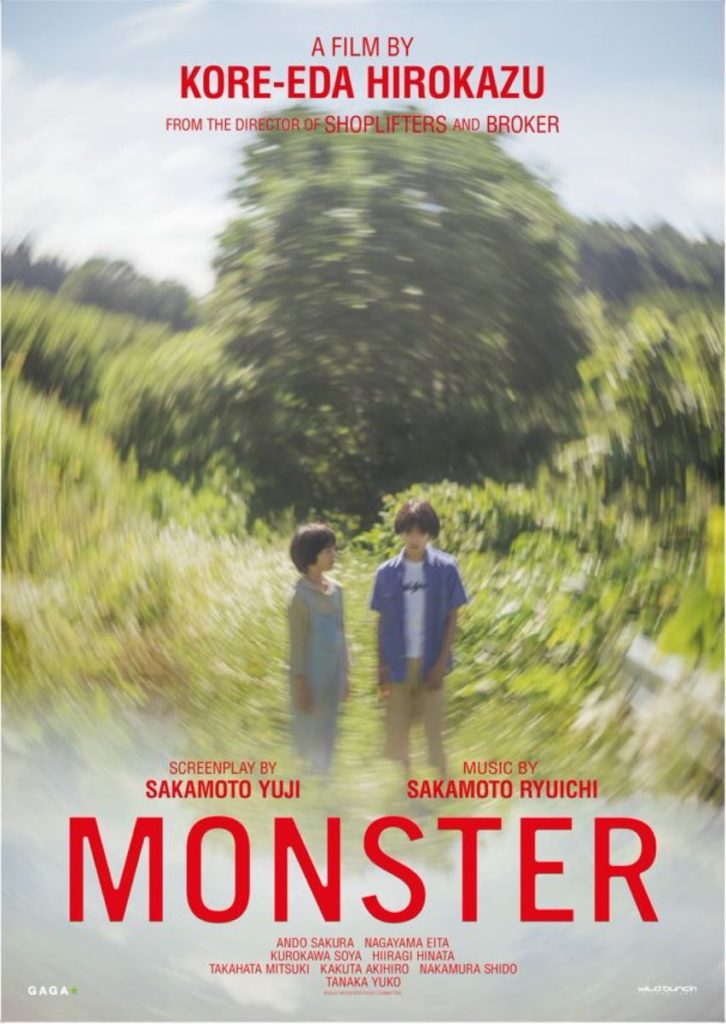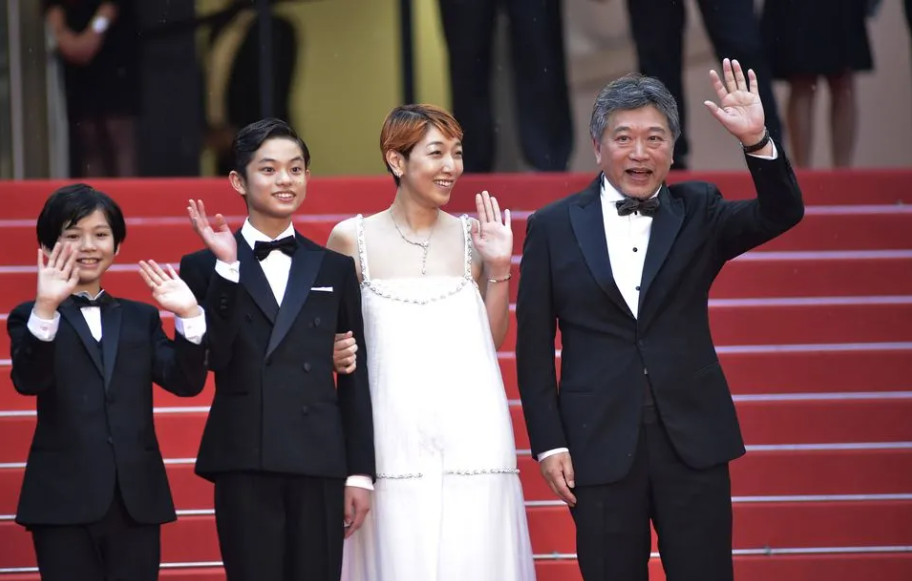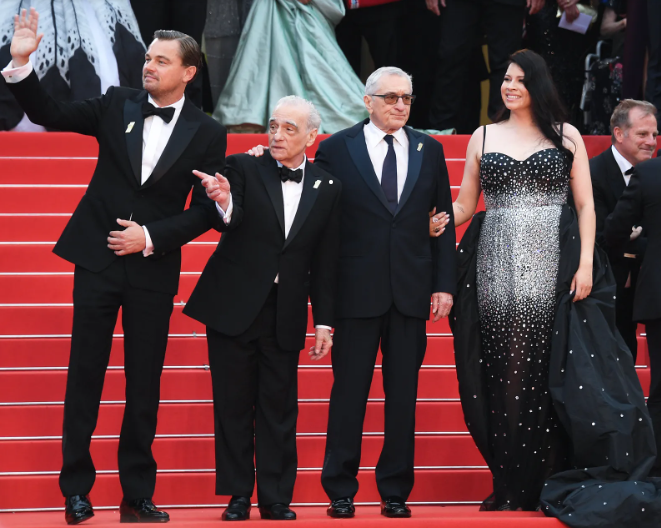Quelques photos, quelques palaces , pour le plaisir…






La féérie de Cannes, ce sont ses palaces. Le Martinez, Le Majestic, Le Carlton. Le trio triomphant de la Croisette. Du rêve, du glamour, du chic, du faste, et du cinéma. Voyage dans les étoiles, dans les cinq étoiles.
D’abord, il y a le Martinez. Le mythique Martinez. Le célèbre palace, refait à neuf, offre aux convives une myriade de chambres de style Art Déco contemporain aux tons doux, au style épuré. Blancheur des murs, mobilier blanc crémeux, blanc laqué, blanc brillant, blanc immaculé, agrémenté d’une infime touche de pastel bleu ou jaune. On peine à détacher ses yeux de cet univers laiteux, de ce jet de lait, cette neige cotonneuse, qui illumine l’espace d’une lumière irisée. On baigne dans une bulle neigeuse, incroyablement apaisante et la vie semble infiniment douce. L’instant s’éternise et il porte un double nom : quiétude, plénitude. Côté mer, une vue imprenable. Côté espace vert, les fenêtres s’ouvrent, sur un jardin zen aux parfums de citronniers et d’oliviers. Baignée dans une lumière pulpeuse, vaporeuse, radieuse, une ravissante piscine bleu outre-mer barbotte entre les arbres. Pure poésie. On imagine aisément la silhouette de Francis Scott Fitzgerald arpenter avec délicatesse, entre rêve et songe, les couloirs du Martinez, appelé par ce jardin d’éden, ce havre de paix intemporelle, un Fitzgerald ébloui par la beauté des lieux. Plaisir des yeux. Mais aussi plaisir des papilles. Côté cuisine, le chef étoilé Jean Imbert vient de succéder à Christian Sinicropi. Il dirige La plage du Martinez, et sera bientôt aux commandes, au printemps 2024, du restaurant doublement étoilé au Michelin, du Martinez, La Palme d’or. Le jeune chef surdoué n’a pas son pareil pour régaler les palais les plus exigeants. Ses fulgurances culinaires expliquent sa fulgurante ascension. Chez lui, le moindre plat frise le génie. Disons-le tout net, nous avons dégusté au Martinez la meilleure pizza au monde ! Impossible de ne pas évoquer cette merveille culinaire, renversante, succulente, exquise, incroyablement délicieuse, bonne à se damner. Rien de moins ! Et le lendemain matin, le petit déjeuner ne démentait pas cette impression d’excellence, avec un jeu de gaufres irrésistibles, miracle de moelleux, qui fondaient sous le palais, si délicieuses qu’on en perdrait à tout jamais ses bonnes résolutions de régime. Ajouter à cela, un staff de voituriers, tous plus canon, charmants et bienveillants les uns que les autres, des oeuvres d’art sublimes à chaque coin de l’hôtel, un grand escalier graphique et son lustre rétro, un défilé permanent de stars, le Martinez a tout de la féerie, du faste d’une fête magique et grandiose des années folles, digne des soirées de Gatsby le Magnifique.



Ensuite, il y a le Majestic. Majestueux, impérial, grandiose. Magnifique fleuron des établissements Barrière, ce palace parade en tête des plus beaux palaces de la planète. On succombe dès l’entrée à l’incomparable accueil que vous fait le personnel. Vous êtes, en une fraction de seconde, l’être le plus important au monde. Choyé, chouchouté comme jamais, vous vous sentez délicieusement unique. C’est la philosophie de cette adresse culte : on y cultive la courtoisie. Et cette impression ne vous quitte plus de votre séjour. On fond littéralement devant la pluie d’attentions qui se déverse généreusement sur votre personne : cadeaux, goûter de fruits, fabuleuses pâtisseries offertes, nectar de fruits à l’incroyable saveur. Le personnel, les gouvernantes, les femmes de chambre, tout sourires, sont aux petits soins. Tous anticipent le moindre de vos désirs. Sitôt quitté votre spacieuse chambre, vous découvrez dans l’enfilade des salons raffinés des buffets beaux à couper le souffle, dressés avec un goût irréprochable. C’est l’extase visuelle. Terre et mer enchantent l’assiette. On s’émerveille devant la farandole de fruits de mer, on s’enthousiasme devant la variété des mets exquis, les mariages de saveurs, les alliances de flaveurs, toutes ces nourritures terrestres plus alléchantes les unes que les autres. Et on finit par craquer pour le buffet de desserts, sublime de bout en bout. Pas moins d’une trentaine de pâtisseries alignées placidement vous convient au plaisir. Ce délice, c’est le supplice de tantale. Le chef pâtissier, Michaël Durieux, au sommet de son art, flirte avec les cimes. Festoyer au Majestic, c’est arracher un peu de paradis au ciel, et ça c’est tout simplement magique. En somme, dans cette adresse incontournable de Cannes, dans ce palace inoubliable, on reçoit beaucoup d’amour. On repart du Majestic galvanisé, transfiguré, avec une seule envie, le désir d’y retourner.



Enfin, il y a le Carlton. « L’hôtel du cinéma » par excellence où fut tourné le film La main au Collet d’Alfred Hitchcock. On se souvient tous de la fameuse scène de la chambre 623 qui réunit le duo de stars Grâce Kelly et Cary Grant, devenue aujourd’hui la suite Alfred Hitchcock. Le splendide palace, métamorphosé après des travaux pharaoniques, brille aujourd’hui de mille feux. Il propose le paradis sur terre grâce à son jardin d’éden digne des jardins de l’Alhambra. Dans cette atmosphère sensuelle, végétale, minérale, nos cinq sens sont comblés. Le plaisir de l’ouïe, avec le murmure de l’eau, le doux clapotis de la piscine à débordement sertie de palmiers. Le plaisir de l’odorat avec le parfum envoûtant des essences de fleurs, les fragrances fabuleuses des plantes aromatiques. Le plaisir de la vue qui ne peut se rassasier de ces jeux d’ombre et de lumière, de ce ciel azuréen comme unique toit du joyau bleu de la piscine, de la variété exquise des couleurs de ce jardin méditerranéen. Le plaisir du toucher dû à la découverte des matériaux, et enfin le plaisir du goût, avec la saveur des fruits, les agrumes et le joli bar attenant à la piscine qui offre des boissons détox comme des tisanes au gingembre. Félicité visuelle, acoustique, aromatique, gustative, et tactile. Pur moment de bonheur dans un cadre de pure beauté. Une forme de perfection pour le Carlton, excepté l’accueil un peu froid et snob (snob dont l’étymologie est sine nobilitate) et qui donc manque de noblesse.
Isabelle Gaudé