« J’ai tellement aimé ma mère que j’aime toutes les femmes »

Dans les livres de Frégni, il y a de la passion, du plaisir, de la folie, du génie, de la rage, de la révolte, de l’amour fou, de la volupté, « du bruit et de la fureur ». C’est tout le sud de Giono qui gronde entre ces lignes, avec la force d’un rugissement, d’un roulement de tambour, d’un bouillonnement. On est éclaboussé de lumière, ébloui par le soleil et par l’ombre, on flirte avec Dieu et le Diable, entre fulgurance et fracas. C’est un cri, c’est un don. C’est flamboyant comme l’été dans les collines à Manosque… C’est Giono au XXIème siècle.
Dans les livres de Frégni, il y a de la passion, du plaisir, de la folie, du génie, de la rage, de la révolte, de l’amour fou, de la volupté, « du bruit et de la fureur ». C’est tout le sud de Giono qui gronde entre ces lignes, avec la force d’un rugissement, d’un roulement de tambour, d’un bouillonnement. On est éclaboussé de lumière, ébloui par le soleil et par l’ombre, on flirte avec Dieu et le Diable, entre fulgurance et fracas. C’est un cri, c’est un don. C’est flamboyant comme l’été dans les collines à Manosque… C’est Giono au XXIème siècle.
Lire René Frégni, c’est se régénérer. On entre avec délectation dans son dernier roman « Je me souviens de tous vos rêves » qui fleure bon la Provence flamboyante. On tombe dans sa lumière, enivré par cette nature aimée, cette nature belle comme un fruit, et on en ressort ému, foudroyé, « autrement le même » comme dirait Lacan. Durant deux cents pages, on tutoie les étoiles, électrisé par ses mots percutants qui ne sont finalement que le miroir de cette personnalité hors du commun. Car René Frégni est un tempérament ardent, un cœur de poète et « une forteresse de pudeur », il est surtout un immense écrivain qui a l’art de conférer à toute chose une beauté aiguë. C’est pourquoi chacun de ses romans est une rencontre. Une rencontre inoubliable…
On l’aura compris, il n’y a rien de tiède ni de mitigé, rien de petit ni de mesquin chez ce marseillais généreux qui anime depuis des années des ateliers d’écriture dans les prisons. Grâce à la magie des mots, cet écrivain a offert aux détenus la possibilité de s’évader, de fuir l’ombre pour la lumière, de retourner à la vie. Il leur a restitué un imaginaire. Avec René Frégni, la route est belle…
Rencontre avec un écrivain solaire.
René Frégni, vous racontez merveilleusement (dans l’émission littéraire « La Grande Librairie ») que vous avez appris à lire sur les genoux de votre maman. Que les histoires, en l’occurrence « Les Misérables » de Victor Hugo, qu’elle vous lisait enfant, se sont imprégnées de l’amour, irriguées de la chaleur de l’épiderme maternel. « L’enlaçant de tous mes bras, je recevais sa voix par tout mon corps », écrivez-vous. Et vous pleuriez devant la laideur du monde, devant l’abjection des Tenardier et de Javert, et vous pleuriez devant la beauté du monde, devant l’amour de Fantine pour Cosette. Les mots ne vous sont pas entrés par les yeux (vous souffriez d’un fort strabisme étant enfant qui vous empêchait de lire) mais par les oreilles. Peut-on dire comme Nietzsche, que cela a développé en vous « une troisième oreille », celle qui permet de tout voir et de tout entendre, et d’entendre même ce que l’on ne dit pas ?
Dans votre première question, vous apportez vous-mêmes, et déjà, toutes les réponses. Dès que je suis entré au Cours Préparatoire, à l’âge de six ans dans une école de Marseille, les enfants se sont moqués de moi parce que je portais des lunettes. J’étais le seul. Ils m’ont surnommé « Quatre oeil ». Pendant des jours tous m’ont appelé « Quatre oeil ». Il a suffit de ces quelques jours pour que je prenne en horreur l’école.
Un soir j’ai jeté mes lunettes dans une bouche d’égout. Les sarcasmes ont cessé. Je n’avais plus que deux yeux qui n’y voyaient rien. Quand le maître me demandait de lire, la page de mon livre était comme une épaisse nuit de brouillard, je bredouillais et le maître me jetait dans le couloir. La classe n’était qu’une salle de torture. J’ai grandi dans le silence protecteur du couloir, dissimulé sous les manteaux des enfants, afin que le directeur ne m’aperçoive pas en faisant sa ronde.
Seule ma mère a compris l’immensité de mon désarroi. Chaque soir, dès l’âge de sept ans, elle me hissait sur ses genoux, prenait un livre et devant le poêle à charbon de notre cuisine me lisait quelques pages des Misérables ou du Comte de Monte Christo. Comme tout ce que me disait ma mère était juste et vrai, j’ai cru que ces histoires l’étaient aussi. Je pleurais avec Fantine et Cosette, j’aurais voulu écrabouiller Javert et les Ténardier, comme j’étais au côté d’Edmond Dantès lorsqu’il s’évadait du Château d’If et éliminait toutes les crapules qui l’y avaient envoyé croupir.
Rien n’a jamais été plus beau, plus grand, plus émouvant que la voix de ma mère lorsqu’elle me lisait les phrases de Victor Hugo. Les mots vibraient doucement dans sa poitrine et je m’endormais contre la chaleur protectrice de ses seins. Toute la beauté et les horreurs du monde entraient par mes oreilles. Mes yeux m’avaient coupé du monde, la voix de ma mère m’y ramenait.
Votre langue, c’est la langue de l’amour. Vous avez un rapport très sensuel aux mots. Les mots sont vivants pour vous, charnels, gorgés d’émotion, doux et tendres comme la peau soyeuse d’une femme. Est-ce pour cette raison que vous dites que « rien n’est plus érotique que l’écriture » ?
Ma mère était une femme simple. Intelligente, très sensible, mais simple. Pour organiser la maison elle n’employait que des mots simples, des mots qui parlent de jardins, de saisons, de chats et d’enfance. Des mots aussi humbles et discrets qu’elle, des mots presque silencieux et gorgés de vie. Elle ne m’a jamais dit où était la vérité, elle me disait où était la vie. Elle n’était jamais dans l’idéologie, dans le jugement, elle palpitait d’émotion. J’ai compris plus tard la phrase de Balzac: « Plus on juge, moins on aime. » Ma mère n’a jamais jugé personne, elle essayait de comprendre, elle aidait. Je crois qu’elle comprenait tout. Si j’aime autant la présence des femmes, c’est que j’ai adoré plus que tout être près de ma mère, dans cette cuisine, sur les chemin des collines, dans les rues de Marseille. Tenir la main de ma mère, regarder son sourire et entendre sa voix. Tous les mots me viennent de ma mère, ils sont comme sa peau, doux, bienveillants, sensuels, gorgés d’émotion. Ils me protègent.
Dans votre dernier roman « Je me souviens de tous vos rêves », vous écrivez « Je suis vivant parce qu’un cahier m’attend, vierge, encore blanc (…). Il m’oblige à être vivant ». Tirez-vous votre force, votre vitalité des mots ?
Je suis vivant parce qu’un cahier m’attend… Quand j’écris ma mère est vivante. J’écris au stylo sur un cahier d’écolier et je suis à nouveau un enfant. J’invente des voyages, je traverse des forêts d’émotions. J’écris le mot « gare » et je monte dans un train qui n’existe pas. Chaque mot que je dessine à l’encre bleue repousse l’anxiété de devoir disparaître un jour. Je ne suis plus un homme de cinquante ans, de soixante ans, je suis les routes, les ports, les cafés, les gens que s’y rencontrent, s’y déchirent, s’aiment et s’en vont. Je suis la lumière de toutes les saisons, l’écorce d’un arbre, la fuite des nuages, la grâce des femmes. Chaque mot repousse la mort hors de mon cahier. Je suis apaisé. Mon corps prend les dimensions de l’univers. Tant que j’écris je suis immortel. Dès que je referme mon cahier, la mort est devant moi, hideuse. J’ai besoin de ce berceau blanc, de ce voilier qui éloigne le temps. Je ne fuis pas le monde en écrivant, je le regarde vivre et respirer beaucoup plus intensément. J’invente, j’écris, je suis vivant.
Estimez-vous que les mots vous ont sauvé ?
Ce serait énorme que de dire que les mots m’ont sauvé. Chaque jour il m’aident à vivre, à être plus tolérant. Pour écrire il faut descendre dans nos mers profondes, aller très loin à la rencontre de la beauté et des monstres qui sommeillent en nous. La littérature est un combat entre la vie et la mort, le bien et le mal. Quand j’écris, je suis Cosette et Ténardier, Dutroux et Mozart. Je suis la douceur de la peau d’une femme et la cruauté qui habite nos entrailles depuis la nuit des temps.
Sans les mots, je serais certainement devenu un voyou, j’en prenais le chemin. Mes parents étaient pauvres dans un quartier pauvre, très tôt j’ai percuté l’injustice et la méchanceté, j’aurais pu devenir méchant. Il y a eu les mots de ma mère, l’amour de son regard. « L’amour est une main douce qui écarte lentement le destin. » Si je n’avais pas eu cette mère, je serais devenu quelqu’un de très violent. Les mots ne suffisent pas, il faut qu’ils traversent l’amour. Ecoutez le fracas des mots de haine.
Vous écrivez dans le préambule d’un de vos romans : « Plus vous croyez bien faire et plus vous vous enfoncez dans la nuit ». Dans ce roman, coup de poing, « Tu tomberas avec la nuit », on découvre avec horreur qu’à cause de votre bonté, vous êtes entraîné, malgré vous, dans une série de situations stupéfiantes, humiliantes, insensées, quasi kafkaïennes. La bonté, est-ce un aimant qui attire le malheur ?
Non, je ne suis pas meilleur qu’un autre. Je ne suis pas Saint-Paul. J’ai eu besoin il y a une dizaine d’années de quelqu’un de redoutable pour disperser une bande de cinglés qui nous harcelaient ma fille et moi. J’ai fait appel à un truand qui avait été mon élève dans la prison des Baumettes, il a joué son rôle de molosse, d’ancien tueur. Pour remercier cet homme j’ai ouvert avec lui un restaurant. Je n’avais pas prévu la suite qui, certes, a ressemblé durant dix ans au Procès de Kafka. Le juge était plus venimeux que la horde de petites frappes… Heureusement que la vie aussi est un roman, pour le meilleur et pour le pire. Là, j’ai traversé le pire et une fois de plus j’en ai tiré, grâce aux mots, le meilleur, ce livre « Tu tomberas avec la nuit ». Je n’ai pas eu besoin de tuer le juge, je l’ai marqué à l’encre bleue.
Dans votre roman « L’été », vous relatez la passion brûlante, diabolique, destructrice que le héros éprouve pour une femme incendiaire, calculatrice, manipulatrice, dépourvue de scrupules. A nouveau, j’ai envie de vous demander, René Frégni, si en amour aussi, les gens tendres, sentimentaux, affectueux ne sont pas les proies idéales des prédateurs ?
Dans un couple sado-maso, on ne peut pas rendre responsable le sadique, les deux sont complices. Il en est de même dans la passion. C’est parfois une souffrance recherchée, une douleur exquise. Cette femme incendiaire était aussi manipulatrice. Elle aimait mal, parce qu’elle avait été mal aimée. Elle avait souffert et faisait souffrir. Elle était aussi belle que cruelle et froide. Là aussi les mots m’ont soigné, ont refermé les plaies, éloigné les insomnies: » Je n’aurais jamais cru que la cicatrice fut aussi douce à sentir. » disait Musset. Comme le juge, cette femme diaboliquement belle m’a offert un roman. Chaque roman est un miroir dans lequel se reflètent tous nos crimes, démons et merveilles qui étaient en nous et que nous ignorions.
Dans un monde où la perversion se généralise, où « le plus malin » règne en maître et cherche à s’approprier le pouvoir, toutes les vertus humaines, l’honnêteté, la bonté, l’affectivité transforment-elles ceux qui les possèdent en victime ?
A l’âge de vingt ans j’ai cru que la générosité pouvait l’emporter sur l’égoïsme. J’ai été marxiste, tiers-mondiste, guévariste… J’étais persuadé que la vérité appartenait au camp des généreux. Ce camp n’existe pas. Partout le capitalisme a vaincu, le profit a vaincu, le pouvoir a vaincu. Le goût du pouvoir est en chacun de nous, il se développe partout, même dans le camp des généreux. L’URSS, la Chine, l’Amérique Latine, tous ces pays et continents ont basculé dans les puissances obscures de l’argent et du pouvoir. Il n’y a pas les bons et les méchants, cette fable est pour les enfants. Chacun de nous porte en lui Hitler et Jésus, Pol Pot et Mozart, Dutroux et Flaubert. Chacun de nous est responsable de cette dérive sombre des continents.
Gide a un beau mot pour dire que tout ment dans notre monde : « Dans un monde où chacun triche, c’est l’homme vrai qui fait figure de charlatan »… D’accord avec lui ?
Les mots sont le pire et le meilleur. Ils ont façonné Rimbaud, Flaubert, Camus; ils permettent aux grands manipulateurs pervers de dominer les foules, de les subjuguer. Le pouvoir appartient à ceux qui savent parler, à ceux qui utilisent le langage pour tricher, pervertir, corrompre, séduire. Hitler était plutôt laid, malingre, il possédait la magie du verbe… Cervantès a utilisé les mots pour servir la justice, Hitler pour détruire l’humanité. Les mots nous guident vers la beauté ou vers la haine.
Les pages de vos romans transpirent la fraternité, l’amour du prochain. Vous aimez tous vos frères d’infortune, les réprouvés, les rejetés, les reclus, les truands, « les misérables », vous aimez ceux qui ont eu une vie cabossée. Vos romans célèbrent l’entraide. D’où vous vient une telle empathie pour le genre humain ? Avez-vous envie de sauver les autres ?
Ma mère n’était que tendresse, générosité, amour. On m’a tiré de sa chair. Elle m’a appris que personne ne naissait monstrueux, c’est la société qui développe en nous le monstre, c’est l’absence de tendresse, les tours de béton, le chômage, la violence.
Il y a plus de vingt ans que je vais dans les prisons animer des ateliers d’écriture, je n’y rencontre presque que des enfants de la rue et du béton, des enfants grandis dans la violence et la haine. Je suis comme Don Guichotte, je me bats contre l’injustice, contrairement à lui, je sais d’avance que j’ai perdu.
Vous animez des ateliers d’écriture dans la prison des Baumettes depuis 20 ans. Vous dites aux détenus « Posez vos calibres, prenez un stylo ». Pensez-vous que le stylo soit la plus puissante des armes ?
Je vous le disais plus haut, les hommes de pouvoir ne portent pas de calibres, ils ont les poches pleines de mots, de mots malins, tricheurs, pervers. Ils laissent aux autres le soin de s’entretuer. Les mots que je fais entrer en prison parlent de voyages, de saisons, de la beauté des femmes. Ce sont des mots qui fabriquent de vrais hommes dans une université qui n’enseigne que le crime.
René Frégni, vous avez un destin tout à fait romanesque. A 19 ans, vous désertez l’armée, vous fuyez à l’étranger sous une fausse identité, vous êtes rattrapé et enfermé dans une prison militaire dans le Sud de la France. Un aumônier de la prison vous prête alors un livre pour vous permettre de vous évader mentalement. Il s’agit du premier roman de Giono, « Colline ». Vous avez l’impression que la Provence, les incendies d’été, les collines d’or, le soir bleu, la chaleur, le parfum de la lavande entrent par les barreaux de votre cellule. C’est un éblouissement pour vous, lequel vous poussera à devenir écrivain. On dirait le destin de Jean Valjean, dans « Les Misérables », sauvé par un prêtre ! On en revient aux « Misérables ». C’est l’éternel retour, non ?!
Oui, je suis resté six mois dans cette prison militaire, mon cachot faisait sept mètres carrés, il était sombre et glacé. Dans ce cachot j’ai découvert la littérature. Chaque matin j’ouvrais un livre et je partais en voyage, c’est comme si le directeur de la prison m’avait donné les clefs. « Le vent sentait la tuile chaude et le nid d’hirondelle. » Giono me permettait d’être en Provence, dans ces hameaux perdus du Contadour, alors que mon corps immobile tremblait de froid dans sept mètres carrés. J’ai compris dans cette cellule la grandeur des mots. Nos vrais amis sont dans les livres, ils ne nous abandonnent jamais.
Depuis, vous avez pour modèle Giono. Vous avez vécu tous deux à Manosque. Comme lui, vous êtes un autodidacte et un voyageur immobile. Tous deux, en écrivant, vous arpentez chaque jour vos « chemins d’encre ». Giono est un immense romancier, qui crée un langage dans le langage, une poésie. Qu’est-ce qui vous émeut chez lui ?
Giono est avec Proust et Céline, à mon humble avis, l’un des trois grands écrivains du XXème siècle. A chaque ligne il réinvente le monde. Victor Hugo soulevait le monde, Giono le fait chanter, respirer, palpiter, vivre… Je suis comme Giono, j’écris en marchant. Je fais un pas, je ramasse un mot, je fais un autre pas, j’attrape un autre mot. Nos collines sont pleines de lumière, de personnages étranges et de mots.
René Frégni, vos personnages vous ressemblent. Vos héros sont-ils vos miroirs ?
Tout grand livre est un miroir. J’ai été Bardamu, Meursault, Raskolnikov, Julien Sorel, Angelo Pardi. Tous ces personnages ont modelé l’homme que je suis devenu. Mes personnages sont des extensions de moi-même, comme les branches d’un arbre ramifient le tronc. Qu’ils soient bons ou cruels, ils sortent de moi, je les portais en moi comme on porte un enfant. J’ai accouché de mes monstres et de mes saints dans la joie, la souffrance et la concentration, tous sont aussi beaux et laids que chacun de nous. Chacun de nous est un héros de roman qui s’ignore.
René Frégni, croyez-vous en la chance ou pensez-vous que tout est écrit d’avance?
Malheureusement presque tout est écrit d’avance. Certains enfants possèdent six cents mots de plus que d’autres, dès l’entrée au Cours Préparatoire. Tout est presque dit, décidé à cet instant de la vie. La chance ou le hasard sont minuscules face au poids pyramidal de la naissance. La famille, la classe sociale, le quartier sont tellement plus déterminants que le contre poids de l’école. Comptez sur les bancs du Parlement combien d’ouvriers, de petits paysans, de chômeurs, vous ne remplirez pas une main. Le pouvoir appartient à ceux qui naissent dans les mots, la musique, la tendresse. Tous les pouvoirs, celui d’émerveiller, d’agrandir, d’éclairer ou celui de tromper, de dominer, de corrompre. Victor Hugo a tout dit dans une phrase: « La tête de l’homme du peuple… cette tête cultivez-là, défrichez-là, arrosez-là, fécondez-là, moralisez-là, éclairez-là, utilisez-là; vous n’aurez pas besoin de la couper »
Shakespeare écrivait « nous sommes de l’étoffe dont les songes sont faits ». Avez-vous encore des rêves que souhaiteriez voir se réaliser ?
J’espère vivre encore mille ans et marcher pendant mille ans dans les collines. Chaque jour j’ouvre les yeux et je suis ébloui. Comment ai-je eu la chance d’arriver un jour sur cette planète merveilleuse. J’écoute de moins en moins la folie des hommes à la radio, je pars sur les chemins. Les saisons y sont merveilleuses. Chaque jour je regarde et les rêves arrivent. Ecoutez la formule de Pessoa : »Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne veux rien vouloir être, à part ça je porte en moi tous les rêves du monde. » Ma seule ambition est de vivre encore mille ans et de ramasser sur le bord des chemins des rêves lumineux.
Vous aimez les femmes, vous en faites des portraits somptueux. Sont-elles des appels de fiction pour vous, comme l’écrivait Roland Barthes ?
J’ai tellement aimé ma mère que j’aime toutes les femmes. Près de ma mère j’étais heureux, léger, confiant. Les enfants se moquaient de mes yeux. Ma mère m’a dit un jour: « Tu as de très beaux yeux de velours. » J’ai cru ma mère. Je suis persuadé que toutes les femmes trouvent que j’ai de très beaux yeux de velours. Comment ne ferais-je pas de ces femmes des portraits somptueux.
Vous écrivez « Rien n’est plus beau au monde qu’un beau visage de femme ». Pour vous, c’est un paysage, un voyage ?
Quand je suis triste ou inquiet je regarde un très beau visage de femme… Ma peur disparaît. C’est un paysage et un voyage, c’est le seul voyage qui m’emmène de l’autre côté de la mort. La beauté est immortelle.
Que pensez-vous de cette phrase de Paul-Jean Toulet sur l’amour : « amour divine flamme, amour triste fumée » ?
C’est la passion qui est divine flamme, triste fumée. Rien n’est plus violent, sublime, éphémère et douloureux que la passion. Le vrai amour est indestructible. J’aime ma mère comme au premier jour. Le vrai amour vous construit, vous protège, vous rend éternellement beau. La passion vous rend jeune et beau, six mois plus tard vous êtes vieux, laid et bête.
Vous avez écrit un roman magnifique, un roman déchirant sur votre maman : « Elle danse dans le noir », dont la dédicace est « A ma mère morte. A ma mère vivante ». C’est un grand cri d’amour pour une mère qui se meurt. Vous dites que « mortes, nos mères veillent encore sur nous ». Proust disait que « les morts vivent ». Grâce à ce roman qui est de toute beauté, vous avez offert à votre maman un « cercueil de papier ». Vous lui avez offert sa résurrection…
Oui, ma mère n’est pas morte. Elle me tenait la main dans les rues de Marseille. Elle m’a ouvert les portes du monde et de la sensualité. Marseille était bleue dans le sourire de ma mère. Ma mère m’accompagne partout où je vais, elle veille sur moi et je veille sur elle. Rien n’est plus grand que cette douceur. Si j’étais passé sous les roues du tramway, enfant, elle se serait occupé de moi sans jambes. Je m’occupe d’elle, sans vie. J’écris des livres où elle est vivante et elle est partout autour de nous.
Sur quoi écrivez-vous actuellement René Frégni ?
J’écris comme le jour où j’ai pris un stylo dans l’obscurité de cette prison militaire et que j’ai dessiné le premier mot. J’écris sur la lumière, sur la laideur, sur le silence, sur le bien et le mal, sur l’amour et la souffrance. Quand j’écris j’oublie le temps, je suis immortel, ceux que j’aime sont immortels.
Ma mère me regarde écrire, quand je suis en panne elle trouve le mot juste, le plus simple. Elle sourit de me voir penché sur mon cahier d’écolier, moi qui lui ai apporté tant de cheveux blancs. J’écris pour oublier la méchanceté du monde et je vais dans les prisons, ces cités du crime, à l’écart des villes, apporter ce que j’ai de meilleur, la musique de quelques mots. J’écris pour être aimé. J’écris pour aimer. J’écris pour mettre entre la mort et moi l’infini beauté des femmes vêtues de mots.
Propos recueillis par Isabelle Gaudé
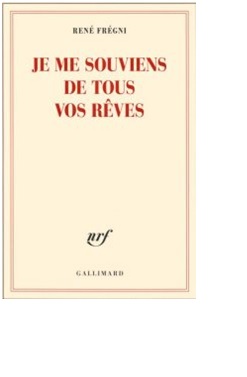
« Je me souviens de vos rêves », de René Fregni. Collection Blanche, NRF, Editions Gallimard. 160 pages. 14€.
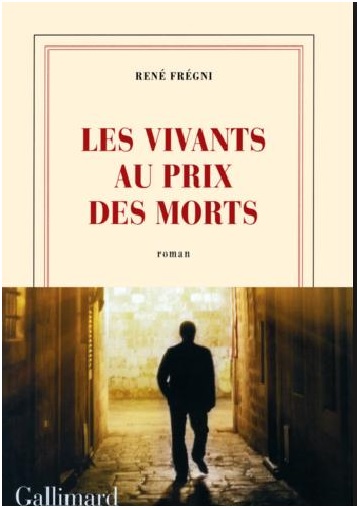
Paru le 4 mai 2017, le dernier roman de René Frégni « Les vivants au prix des morts » aux éditions Gallimard